Stéphanie Chaillou - Le bruit du monde
- Sabine

- 20 déc. 2019
- 3 min de lecture
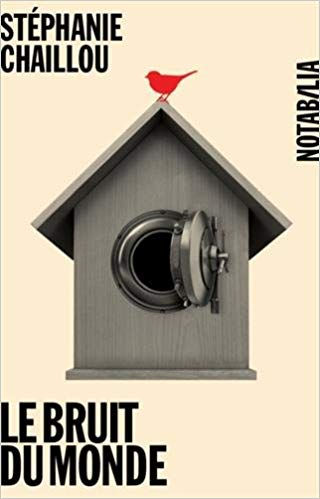
« Marilène se souvient de la force qu’elle a mise à exister. La force qu’elle a déployée pour simplement accomplir cette chose-là, à l’époque, exister. Une force sombre et animale. Une force obscure qui pouvait tout balayer. Parce qu’il y avait quelque part en elle, elle ne savait pas où, une envie brute d’exister. C’était le mot. Exister. Un désir fou de s’affirmer. D’être là avec les autres. De ne pas être effacée. De participer. D’être là. De vraiment compter. »
Il y a des livres qui vous explosent au visage comme explose une bombe à retardement, à fragmentation, une grenade. Sans y prendre garde, on lit juste le titre sur la couverture en ignorant totalement de quoi il est question. Un achat impulsif. Un livre comme une claque, comme cette grenade que vous pensiez bien tenir entre vos mains et qui vous explose sans y prendre garde, sans savoir que vous tomberiez de haut, de tout votre corps et cœur dans ce dédale psychologique d’un moi qui ne demande qu’à se libérer, d’une pauvreté enfin dévoilée, enfin déclarée.
Ne me demandez pas de vous résumer l’histoire… il m’en serait impossible. Cela ressort plutôt d’une analyse philosophique qui chamboule et vous fait réfléchir à la « pauvreté » qui agonise à nos portes, ne peut effacer cette honte, ce profond terrain qui « marécage » en nous/vous, ce vivier boueux qui vous écrase, vous trempe dans un monde où l’on espère passer inaperçu, se rendre lisse et égale aux autres. Un mépris philosophique et sociétal. La face cachée de la richesse qui masque l’ignorance et le mépris, l’intelligence que l’on camoufle.
Un p*** de bouquin comme un brûlot des pauvretés, notre histoire, celle qu’on entérine pour s’accommoder et faire comme ci. Un bruit parasitaire comme un handicap qu’il faut apprendre à colmater, cacher, induire en erreur, se rendre invisible et un jour laisser exploser… La bombe à fragmentation, l’ouverture du coffre fort pendule à coucou.
« Marie-Hélène Coulanges, dite Marilène, est née le 18 juillet 1964 dans une famille pauvre. Ce n‘est pas noté sur sa carte d’identité. la carte d’identité de Marie-Hélène Coulanges s’en tient exclusivement aux informations administratives. Sur sa carte d’identité, Marilène n’est pas pauvre. Elle est seulement née le 18 juillet 1964 à Pouzauges. Elle peut tout devenir. »
Sauf que ne rien peut se réparer, décortiquer, abattre une forêt, en l’espace d’un morceau de vie, à faire face à notre pauvreté, à cette pauvreté angoissante, lourde comme un costume que l’on endosse chaque jour. Un costume qui nous rend invisible à nous même et aux yeux des autres. Un costume comme une armure qui se fend au fur et à mesure de ce besoin fondamental d’exister, d’être enfin à égal et surtout libre de ce passé qui nous embourbe.
« Elle dit qu’elle n’avait jamais pu maîtriser ces mouvements de honte qui l’envahissaient parfois. Comme si elle avait eu une tache au milieu du front. Qu’elle se promenait dans le monde avec une tache honteuse au milieu du front. Une tache qui n’était pas toujours présente, mais qui, inopinément, sans qu’elle sache pourquoi, revenait soudain. Comme pour la rappeler à l’ordre. Qu’elle n’oublie pas. Qu’elle demeure qui elle était. » « Que les choses se passaient ainsi quand on était pauvre. Qu’on avait déjà honte avant même de commencer à respirer. Qu’aussi la révolte était loin. Aussi loin que l’image absente de la personne que l’on n’était pas. »
Un roman qui chamboule nos habitudes, nos cases bien ordonnées, nos vilains mensonges, nos pauvretés camouflées, ce quotidien avec qui on tente de s’accommoder. Un livre qui donne une claque, une énergie, un réveil, un coffre qu’on ouvre et d’où on laisse échapper nos misères, nos pauvretés affectives, intellectuelles, de pacotilles ou réelles. Un roman comme une révolte que l’on s’autorise à croire, à faire, à lutter contre ces cases dans lesquelles on nous a parqué, uniformisé, dans lesquelles on ne se reconnait pas, on ne se reconnait plus, on lutte, on s’extirpe comme on s’extirpe du bourbier routinier d’une vie calquée dans laquelle on nous a assigné.
Une écriture qui prend là où ça fait mal, appuie et nous laisse exsangue et à la fois nous fait penser que le bruit du monde est notre bruit à nous, celui que l’on désire donner. Saisissant et salutaire.
« Assise à une terrasse de café, un soir de juin 1993, Marie-Hélène Coulanges, dite Marilène, ose se dire qu’elle aussi peut vivre. Qu’elle aussi peut avoir des envies. Des envies bêtes, petites, éphémères. Des envies futiles de jeune femme vivante. De jeune femme fraîche, pas totalement ravagée. De jeune femme vivante, avec un corps et des émotions. Pas de morte à demi vivante. Assise à une terrasse de café, un soir de juin 1993, Marie-Hélène Coulanges, dite Marilène, renoue enfin avec l’idée des possibles. Cela lui enlève un poids dans la poitrine. »




J'aime beaucoup cette maison d'édition!